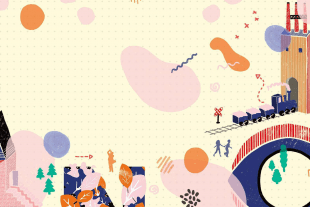Joël Pommerat, après trois adaptations de vos pièces à l’opéra, comment êtes-vous passé à l’écriture d’un livret original ?
Joël Pommerat – Pour mon premier opéra, Thanks to my Eyes, partir d’une de mes pièces était sécurisant. Dès mon 2e opéra, je me suis posé la question de faire une création. Mais par manque de temps ça n’a pas pu se faire. Après Pinocchio, il était clair qu’il fallait ou arrêter ou travailler sur une création. Il fallait engager un processus différent, ce qui impliquait par contre de disposer de beaucoup plus de temps, au moins une année pour explorer la question de l’écriture d’un livret original.
On a beaucoup discuté avec Olivier Mantei de la question du processus, dans l’idée de le rapprocher le plus possible d’un processus d’écriture qui m’est familier au théâtre, en aller-retour avec la scène. Je voulais développer le plus possible une collaboration avec le compositeur en amont de l’écriture et même pendant. Nous avons aussi discuté du rapport d’équilibre entre les deux écritures, théâtrale et musicale. Pouvait-on les concevoir en équilibre, sans rapports de force, dans une recherche de création vraiment globale et même organique ? En réponse à ces interrogations, Olivier m’a présenté Francesco.
Francesco Filidei, qu’est-ce que l’opéra représente dans votre vie de compositeur ?
Francesco Filidei – J’ai beaucoup réfléchi au pourquoi de l’opéra, et j’ai compris que c’était cohérent avec mon parcours de compositeur dans lequel les références aux formes du passé sont nombreuses. Je m’intéresse aux formes de la culture européenne car elles permettent de retrouver la mémoire de notre histoire à travers ce qui a été vécu auparavant, par d’autres. L’opéra est une « forme morte », qui a connu son apogée et sa signification maximale dans la société européenne à une époque révolue. Aujourd’hui, même le film de cinéma semble sur le point de mourir. Or cela m’intéresse de travailler avec le « cadavre » de l’opéra, d’essayer de le ranimer. Une démarche dont témoignent, dans d’autres genres musicaux, certains de mes titres : Notturno en 1992, Danza macabra en 1996, Ricercare en 2006, ou encore Concertino d’Autunno en 2007.
J’arrive à mieux comprendre le compositeur que je suis en m’inscrivant dans le temps qui passe. De cette démarche, quelle vie puis-je tirer ? Eh bien une pièce de musique est pour moi comme une maquette de la vie. Comme une vie humaine, la pièce naît, vit et meurt dans le temps. Il en reste une maquette : la partition. Toute musique a une durée courte, finie, perceptible, et vit de formes closes. Elle a donc vocation à permettre de comprendre qui on est, où on va – en tout cas qu’on va quelque part. Grâce à la musique, le compositeur et les interprètes donnent vie à l’inanimé, que ce soit une forme musicale, un instrument… Avec le concours des auditeurs, les musiciens donnent aussi vie aux formes vides et minérales que sont les salles de concert, les théâtres. Je crois donc que la musique nous accompagne dans la compréhension de notre vie.
Comment en êtes-vous tous deux venus à L’Inondation de Zamiatine ?
Joël Pommerat – J’avais l’intention de proposer plusieurs sujets à Francesco à partir d’œuvres littéraires. Il a eu je crois une évidence pour la première proposition, L’Inondation. J’ai découvert cette nouvelle il y a longtemps. À sa lecture, j’avais eu un petit choc esthétique qui a ensuite beaucoup marqué mon écriture. Ce texte est à la fois réaliste et métaphysique. L’implicite se révèle de façon à la fois concrète et sensible. Comme dans un conte, les personnages et les actions sont simples et élémentaires, il s’agit de relations et d’émotions qu’on pourrait qualifier de fondamentales. Il est dit et suggéré beaucoup dans une économie de moyens, cela laisse beaucoup de creux et d’espace pour l’imaginaire et la musique.
C’est une œuvre qui m’a marqué autant pour ce qu’elle raconte que par la façon dont elle le raconte.
À la manière des contes, l’auteur décrit mais n’explique pas, il montre des personnages en train d’agir ou de réagir, la causalité des choses n’est pas traitée, ce n’est pas le sujet. On traite bien évidemment de psychologie humaine, mais sans jamais faire d’analyse psychologique.
En parlant de vent et d’air, d’eau, de chaud, de froid, d’éléments naturels et de sensations physiques, c’est finalement une mécanique voire une physique des sentiments que Zamiatine a créée.
Francesco Filidei – Joël avait l’intuition que L’Inondation correspondait à ce qu’il me fallait. Zamiatine n’était pas seulement ingénieur naval (constructeur de brise-glace) et écrivain. Il était aussi fils d’une musicienne (et d’un instituteur), et musicien lui-même. Il a contribué en 1927-1928 au livret du Nez, l’opéra de Chostakovitch d’après Gogol. Toute son écriture est musicale. Dans L’Inondation, l’écrivain « orchestre » le milieu dans lequel vivent les personnages. Leurs paroles sont rares. En revanche, les phénomènes atmosphériques sont omniprésents comme le sont le fleuve, les mouches, les sons de l’immeuble, du voisinage. Tout cela compose un macro-monde autour du flux de conscience des personnages, et tout cela envahit leur vie intérieure. L’orchestration peut prendre en charge ce milieu.
Joël a ainsi orchestré l’espace de l’opéra, et moi, le temps et l’atmosphère. Là-dedans, les voix sont des objets. Dès le début s’est imposé un chant assez debussyste, d’une simplicité à l’image du texte : peu de mots, donc des intervalles réduits, des secondes, des tierces, exposés de façon géométrique par la comptine qui, ouvrant et fermant l’œuvre, sert de base à toute la composition. Ensuite, c’est à l’orchestre de donner de la profondeur et une portée aux mots, aux pensées, au destin.
Par quelles étapes est passée l’adaptation du roman au livret ?
Joël Pommerat – Quoique court, le roman fractionne beaucoup l’action et insiste davantage sur ce que pensent les personnages que sur ce qu’ils disent. Il a fallu resserrer, adapter, se réapproprier ce texte, pour en faire un objet très différent de la littérature. C’était une sorte de sacrifice de l’œuvre en fait. Sa cohérence initiale est forcément perdue dans un tel travail.
Il a fallu accélérer l’évolution des relations entre les personnages, en misant sur des ellipses. Il a fallu rendre sensible le passage du temps, charger chaque scène du temps écoulé depuis la précédente.
Par exemple rendre perceptible le passage des saisons permet d’évoquer cet écoulement du temps.
Vous avez ensemble écrit le dialogue et composé la musique : comment est née cette parole chantée ?
Joël Pommerat – L’adaptation de ce roman en livret soulevait la question du langage. Car ces personnages ne parlent pas, c’est même leur problème d’ailleurs. Mais comment transposer cela dans un opéra ? Dans un premier temps, j’ai proposé à Francesco un découpage en une dizaine de scènes. Nous en avons discuté. Ensuite j’ai écrit les premières scènes. On a organisé des séances de travail avec des chanteurs et chanteuses pour improviser musicalement sur ce premier matériau.
Francesco Filidei – On lisait le dialogue une ou deux fois. Au violoncelle, Séverine Ballon créait des ambiances sur mes indications. On relisait. Chaque matin, j’esquissais le chant avec le texte. L’après-midi, j’écrivais rapidement la mélodie au piano, comme un peintre d’après modèle, en cherchant à rendre justice à la vie et au souffle de chaque interprète. Le lendemain, on jouait l’esquisse, on retouchait. Joël y intégrait le temps nécessaire pour les déplacements et les actions scéniques. On enregistrait le résultat. Ensuite, je reportais l’ensemble à l’ordinateur et je faisais une maquette. Cette première étape de la composition, scène par scène, est allée assez rapidement. Elle a permis d’encapsuler la présence vivante des interprètes engagés pour les ateliers.
Joël Pommerat – On a discuté, on a négocié et on a cherché à comprendre les nécessités de l’autre. J’essayais de comprendre les nécessités de la musique et Francesco cherchait je crois à comprendre mes nécessités d’écriture et de mise en scène. Après discussion, je transformais, ou bien j’essayais de tenir bon si cela me semblait essentiel.
Le français étant une langue étrangère pour Francesco, il m’a souvent demandé de lui préciser telle ou telle prononciation. Nous n’avons pas essayé de poser des principes prosodiques, comme le traitement du e muet. Toute expression musicale me paraissant contre-naturelle, je n’ai pas à demander de changement. Quand j’écris, je n’imagine jamais mon texte chanté ! L’écriture vocale est donc à 100% de Francesco.
J’ai parfois introduit une sorte de lyrisme, ou de romantisme, pour sortir de la trivialité de mon écriture, trouver un équilibre entre le prosaïsme qu’appellent ces personnages et ce qui est destiné à être chanté. Dans la trivialité, quelque chose peut résister au chant. À chaque fois que la trivialité fonctionnait, on l’a gardée. Les ajustements ont permis que ce qui fonctionnait en parlant continue à fonctionner en chantant.
Mais le plus difficile dans l’écriture d’opéra, pour moi, c’est de comprendre la temporalité. Une phrase qui semble juste peut devenir très artificielle dans une temporalité très différente de celle que j’avais imaginée. Le silence ou le temps entre deux paroles ou deux phrases charge ou appuie le sens d’une manière que je ne contrôle plus en tant qu’écrivain.
Francesco Filidei – J’ai beaucoup appris dans ce travail d’aller-retour avec un auteur-metteur en scène. Jusqu’alors, je gérais librement la structure de mes compositions. Là, j’ai dû répondre aux directions que souhaitait emprunter Joël. Je n’ai pas travaillé sur les formes musicales, mais dans le déroulement dramatique, d’après des matériaux qui pouvaient résister, comme un sculpteur. J’ai compris que certaines situations n’invitaient pas à faire de la musique, si on voulait que le récit avance, qu’il y ait de l’action. Il fallait des dialogues de mise en place, pas uniquement des situations musicales… Finalement, j’ai expérimenté la pertinence de la complémentarité entre airs et récitatifs !
Deux personnages sont, pour l’un double, pour l’autre dédoublé : pourquoi ?
Joël Pommerat – Le policier devient par moment narrateur, ou plutôt prend parfois en charge cette fonction, sans pour autant se dédoubler. Il met des mots sur ce que les personnages ne peuvent formuler. Il évoque aussi de simples faits, indispensables au déroulement de l’histoire, qu’il aurait été lourd et artificiel de faire porter par les personnages.
C’est une solution que j’ai utilisée dans beaucoup de mes pièces. Cette parole surplombante décharge mes personnages de l’obligation de parler, d’être d’abord des êtres de parole et de dire des choses non nécessaires. Ils peuvent ainsi vivre plus librement au plateau. Je suis donc parti de bases qui me sont propres pour écrire ce livret. Même si j’aime également le principe narratif du dedans/dehors – la capacité d’un personnage de parler de soi à la 3e personne, qui offre d’autres solutions, mais qui ne plaisait pas trop à Francesco.
Concernant le personnage de la jeune fille, je ressentais la nécessité, aussi bien dans l’écriture que dans la mise en scène – puisque je les pense de façon fusionnée – de la montrer en décalage avec les adultes. Francesco, lui, ne souhaitait pas une voix d’enfant pour interpréter ce rôle. Il s’avérait donc impossible de confier l’interprétation à une chanteuse : elle n’aurait jamais été assez jeune.
Le problème a trouvé sa solution lorsque j’ai considéré ce qu’allait nous apporter le dédoublement du personnage : une très jeune comédienne et une chanteuse. Cette difficulté de départ a ouvert beaucoup de possibilités de mise en scène et même d’écriture. Son dédoublement s’est avéré absolument juste du point de vue du sens et de l’écriture.
Parlez-nous des voix des personnages.
Francesco Filidei – Nous avons convenu avec Joël des tessitures vocales des personnages. Nous avons choisi un baryton clair pour l’homme, afin de camper un personnage encore jeune, et un mezzo presque soprano pour la femme, dont le chant reste en arrière jusqu’à l’explosion de l’aveu qui l’amène dans l’aigu, jusqu’au do. Par contraste, le voisin est donc ténor et la voisine mezzo grave, ce qui lui donne de la maturité. La difficulté majeure concernait les voix d’enfants et celle de la jeune fille. Comme celle-ci a une voix de soprano au chant simple et juvénile, la vocalité enfantine est reportée sur les enfants de la voisine, interprétés par des maîtrisiens de l’Opéra Comique. Et la scène 8 valorise la part d’enfance de la jeune fille en la faisant dialoguer avec ces enfants. Enfin j’ai voulu dégager le narrateur de l’action grâce à la tessiture de contre-ténor. Elle me donne aussi l’occasion de composer un chant libre, plus lyrique que dans les dialogues. Le docteur lui aussi a sa vocalité propre : basse, il s’exprime tout en staccato, marquant ainsi le passage dans un autre milieu, celui de l’hôpital. Globalement, les protagonistes s’expriment avec naturel, et nos interprètes travaillent l’intelligibilité du texte. Tout cela met en relief le moment lyrique et extrême de l’aveu.
Et l’orchestre ?
Francesco Filidei – L’orchestre prend en charge le macrocosme des éléments, du quartier, de l’immeuble, mais aussi ses effets et ses échos dans la vie intérieure des personnages : il est très important et m’a longuement mobilisé. Il présente une forme assez classique, avec une importante section de percussions, habituelle chez moi, tenue par cinq musiciens dont deux placés dans les loges latérales. La liste des percussions est longue et comprend des appeaux, un taser, etc. Tous les sons sont naturels.
L’évocation des sons concrets m’intéresse : on entend des mouches, le vent, l’eau qui monte, mais aussi les gammes du piano chez des voisins – et d’une scène à l’autre, on entend que l’élève a progressé. Cela contribue au réalisme et à la théâtralité tout en restant une création musicale. L’univers sonore des protagonistes est traduit par la musique, sauf le moment où la femme découvre qu’elle est trompée. Alors, la musique disparaît quasiment au profit des bruits qui résonnent dans un silence impitoyable. De même alors, le chant n’est plus possible et disparaît au profit du parlé.
Enfin, j’ai voulu créer une forme de capsule temporelle, à l’instar du décor, en restituant des caractéristiques sonores des années 50, celles des disques tournant dans les gramophones.
La nouvelle se situe en Russie à la fin des années 1920 : pourquoi avoir transposé cet univers ?
Joël Pommerat – La langue française de l’œuvre interdisait de reconstituer la Russie. Par ailleurs, l’histoire ne pouvait pas se dérouler en 2019, mais pas non plus dans les années 20-30 : cela m’aurait obligé à une sorte de reconstitution historique que je juge artificielle au théâtre.
J’ai cherché à définir dans mon écriture une sorte de passé-présent non réaliste me permettant de traiter la situation de départ sans trop d’anachronisme. On va dire qu’on se situe dans un temps inventé : un passé de la modernité, qu’on pourrait situer dans les années 50-60-70.
Mon propos n’est pas de mettre en scène un jugement moral sur des individus mais de considérer cette histoire comme une tragédie, une histoire de la violence où l’intime et le social ne sont pas considérés à part l’un de l’autre.
Francesco Filidei – Les institutions aiment aujourd’hui qu’une œuvre nouvelle comporte une problématique sociale ou politique. En revanche, tirer le sujet du présent ne s’impose pas. Le présent est toujours là, il résonne dans le passé que nous mettons en scène, quel qu’il soit. Dans son apostille au Nom de la rose, Umberto Eco a expliqué en quoi le passé permet de retrouver le présent : « La réponse postmoderne au moderne consiste à reconnaître que le passé, étant donné qu’il ne peut être détruit parce que sa destruction conduit au silence, doit être revisité : d’une façon non innocente. » En tant qu’écrivain pris dans l’histoire soviétique, Zamiatine avait beaucoup réfléchi sur la relation de l’écrivain au passé, à l’héritage. Joël savait bien comment donner une actualité à ce texte de 1929.
Dans quel univers visuel se déroule cette histoire ?
Joël Pommerat – J’ai d’abord pensé à un espace dématérialisé, permettant de figurer tour à tour le dedans et le dehors, le monde réel et le monde mental. Pour écrire j’ai besoin d’avoir une sensation assez précise de l’espace scénographique. Je cherchais un dispositif simple, non naturaliste, qui n’enferme pas l’action, les personnages et les spectateurs dans un espace unique et matériel.
J’ai développé mon écriture théâtrale depuis mes débuts dans ce refus du décor unique, réaliste et figeant.
Ce qui a déterminé le décor actuel, à l’opposé de ces fondamentaux, et qui est un revirement complet par rapport à mes intuitions de départ, s’est passé à l’écoute de la maquette de l’opéra sur l’ordinateur de Francesco. Cette immersion dans la temporalité musicale construite par Francesco a été un choc. J’ai réalisé combien la musique dilatait le temps du dialogue. Et combien l’action « silencieuse » des personnages devait prendre de l’importance.
Les personnages de cette histoire sont enfermés dans leur quotidien : leurs actions, même anodines, sont signifiantes. Mais dans cet étirement du temps, la lenteur peut aussi surcharger l’action de pathos, et le tragique devenir un mélodrame pesant.
L’idée que j’ai formulée lors de cette séance de travail était d’offrir une simultanéité de points de vue sur les actions, en montrant les trois étages de l’immeuble où se déroule l’action non pas un à un, mais ensemble. Vues en simultané d’actions banales, certaines actions primordiales de l’histoire sont ainsi enrichies. Ce contrepoint d’actions renvoie d’ailleurs à l’écriture musicale il me semble.
Ce décor matérialise aussi un grand corps social où sont pris les individus, à la fois dépendants les uns des autres et confinés dans leur solitude.
Dans la continuité d’actions anodines vues en simultané se dessine encore mieux l’organisation sociale dans laquelle évoluent les personnages, qui les structure et les enferme. La répétition des gestes et des actions devient musicale et chorégraphique, signifiante et pas seulement redondante. Par exemple la répartition des rôles sociaux entre hommes et femmes se manifeste mieux dans un tel espace.
Avec cet opéra, Francesco Filidei, comment vous situez-vous dans la création musicale, et par rapport à l’Opéra Comique ?
Francesco Filidei – Je suis un compositeur italien installé en France, comme tant d’autres avant moi ! Je suis heureux de m’inscrire avec Joël dans la longue histoire des rencontres entre théâtre français et opéra italien.
À l’Opéra Comique, je perçois la présence de Massenet, Puccini, Debussy. C’est le creuset de l’art lyrique contemporain, la salle pensée pour favoriser la rencontre du théâtre et de la musique. J’ai voulu me couler dans le moule classique de l’opéra afin de le briser de l’intérieur. J’accueille ce que donne le lieu avec le désir de transformer le genre et l’objectif de donner à chacun de ses éléments un nouveau sens. Pas brutalement : je suis convaincu qu’il faut d’abord construire pour, ensuite, transformer. Donc, j’ai un orchestre en fosse, un chef qui dirige, des chanteurs avec des voix non amplifiées : on est dans l’histoire. À partir de là, il est possible d’inventer un agencement nouveau, de détourner les usages. Comme on pourrait, dans un musée d’art moderne, proposer une installation faite d’œuvres anciennes, ce qui amènerait les spectateurs à changer de regard sur le tout et les parties du tout. Quand Joël a proposé de déplacer l’événement crucial de l’histoire au début de l’opéra, je me suis dit que cette dislocation du récit ouvrait la voie à un travail de l’intérieur sur l’héritage musical. Je n’avais plus à renoncer à l’orchestre, je pouvais même me permettre de composer une chanson, un duo. La forme est la base à partir de laquelle penser le bouleversement de la forme.
Cela n’a pas été facile ! J’écris assez rapidement, mais cette recherche de sens et de cohérence est éprouvante. Il fallait que je trouve la clé, la formule qui rendrait cet opéra particulier et pertinent dans son rapport au passé – aux passés de l’action, du genre, du langage…
Parmi les films que nous avons visionnés pendant la préparation de cet opéra, à l’invitation de Marion Boudier, l’un m’a fourni une image importante. C’est Répulsion de Polanski, avec cette fissure qui s’élargit dans un mur. J’ai imaginé que la musique se fissure de temps en temps, pour exprimer les symptômes de la folie de la femme.
Ainsi, la division de notre opéra en deux actes a été dictée par une nécessité musicale : la tension explose en effet avec l’arrivée de l’inondation, et nous ne devions pas la faire retomber. Il fallait plutôt que la musique s’arrête brutalement, et laisse ainsi une impression forte, qui détermine la façon dont on aborde ensuite le second acte. Cette béance, cette faille entre les deux actes crée une fracture dans le temps de la représentation : un même geste ferme le 1er acte et ouvre le 2e, marquant une cassure nette. Les spectateurs n’en comprennent que plus clairement la tension qui menace les protagonistes pour lesquels, en revanche, le temps dramatique reste un continuum.
J’ai aussi compris que la scène finale de l’aveu, dans une perte totale de contrôle de sa parole par la femme, devait être à l’orchestre celle d’une destruction. Des souffles incontrôlables, comme les courants du fleuve en crue, inondent donc la fosse, submergent les harmoniques. Cette musicalisation du souffle correspond d’ailleurs à la conclusion du conte sur la respiration de la femme : une coïncidence dont je me suis rendu compte après coup.
Cette destruction finale donne du sens aux choix classiques faits jusque-là. Elle répond à ce que j’aime aujourd’hui en musique : être trompé, mystifié, fourvoyé dans ce que je crois être un chemin, pour aboutir à un gouffre.